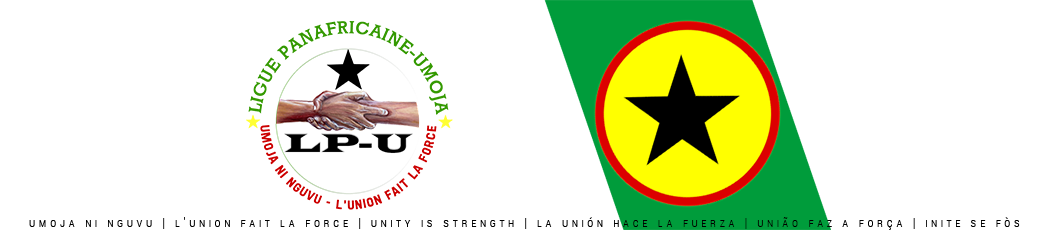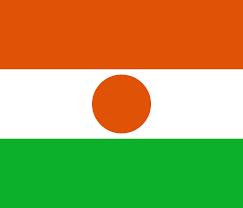« L’histoire Contemporaine de l’Afrique, C’est le Panafricanisme » Entretien de Anne Bocandé avec Amzat Boukari-Yabara Dépoussiérer le Panafricanisme. C’est ce que propose le Chercheur Amzat Boukari dans son ouvrage paru chez La Découverte ; « AFRICA UNITE ! Une Histoire du Panafricanisme ». AFRICULTURES l’a rencontré. Vous évoquez le panafricanisme comme un concept philosophique, un mouvement sociopolitique,
« L’histoire Contemporaine de l’Afrique, C’est le Panafricanisme »
Entretien de Anne Bocandé avec Amzat Boukari-Yabara
Dépoussiérer le Panafricanisme. C’est ce que propose le Chercheur Amzat Boukari dans son ouvrage paru chez La Découverte ; « AFRICA UNITE ! Une Histoire du Panafricanisme ». AFRICULTURES l’a rencontré.
Vous évoquez le panafricanisme comme un concept philosophique, un mouvement sociopolitique, ou une doctrine de l’unité politique. Quelle est la définition du panafricanisme ?
Le panafricanisme est né à la fin du XVIIIe siècle, à peu près en même temps que le libéralisme et le socialisme. Donc, c’est une idéologie très ancienne qui se distingue des deux autres par sa conscience historique, par son identité » géographique « . Le panafricanisme est lié à un continent, un espace. Le panafricanisme est l’équivalent pour l’Afrique, du concept de l’Occident pour l’Europe. L’Australie, l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest, se regroupent dans un même imaginaire dit » occidental » qui montre que la division du monde est en réalité le reflet de la circulation des hommes et des idées. De la même manière, est panafricaine toute société gardant une identité africaine dans son évolution, dans son rapport à l’autre, et dans son rapport à l’idée d’émancipation.
D’autre part, il y a un aspect historiographique : quand on dit que l’histoire de l’Afrique contemporaine commence en 1885 avec la conférence de Berlin, ou en 1960 aux indépendances, cela n’a aucun sens. Mon intérêt était de montrer que le panafricanisme est né en même temps que le libéralisme et le socialisme qui sont liés à la Révolution française, à la Révolution américaine, à l’industrialisation, etc. L’histoire contemporaine de l’Afrique, c’est le panafricanisme. C’est exactement la même profondeur historique. Donc, par conséquent, si on veut écrire l’histoire de l’Afrique, il faut partir du panafricanisme. Find latest news about gambling industry here – casinoscapital.com.
Vous précisez que c’est une histoire liée à un continent, à un espace, mais pas nécessairement à une couleur de peau. C’est à dire ?
Le panafricanisme a d’abord été un pan-négrisme, un sentiment de solidarité entre les Noirs déportés aux Amériques dans le cadre de la traite transatlantique. Ce crime contre l’humanité a accompagné l’essor du capitalisme, c’est-à-dire le système le plus perfectionné d’exploitation et de domination globale de l’homme par l’homme, et donc le système à l’origine du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le racisme – qui stigmatise et assimile la peau noire à la condition servile dans les Amériques – a eu pour réponse une auto-identification, cette fois-ci positive, des Noirs à l’Afrique, mais une Afrique qui était plus imaginée que représentée. Cette imagination vient des passages sur l’Éthiopie dans la Bible ou dans les récits d’esclaves, et donnera plus tard les écrits de la Renaissance de Harlem et de la Négritude.
Par ailleurs, les difficultés internes à Haïti après son indépendance arrachée en 1804, ou encore l’échec de la colonie afro-américaine du Libéria, créée en 1847, vont montrer qu’il ne suffit pas de partager une même couleur de peau pour construire une société harmonieuse ou un projet politique commun. Ainsi, la dénonciation de la colonisation de l’Afrique sous les impérialismes européens dans les années 1880 va conduire les militants afro-américains et caribéens à superposer leur propre condition de ségrégués ou de colonisés avec celle des Noirs vivant sur un continent qu’ils redécouvrent par le biais des premiers historiens afro-américains. L’Afrique passe alors de l’imaginaire à une entité politique concrète quand se répand la nouvelle de la victoire de l’Éthiopie contre l’Italie, à Adwa en 1896.
Éthiopie, Haïti, Libéria… Un espace se crée, et en 1900, à Londres, en présence de militants noirs, mais également de sympathisants blancs, la conférence panafricaine souligne, par la formule très subtile de DuBois, que le grand problème du XXe siècle ne sera pas la couleur de la peau mais la » ligne de couleur « . Que nous est-il possible et que devons nous faire selon que l’on soit d’un côté ou de l’autre de cette ligne ? C’est cette réflexion qui a mobilisé les militants panafricanistes autour de figures comme Marcus Garvey et Tovalou Houenou ou plus tard, Amilcar Cabral et Steve Biko.
En Angola, en Afrique australe, en Algérie, en fait, partout en Afrique où l’indépendance a résulté d’une lutte armée, la question de la ligne de couleur a été abolie par la lutte. Des groupes métis, et de nombreux Blancs à titre individuel, ont parfois réalisé des efforts plus conséquents en faveur de la libération et de l’unification du continent que certains groupes noirs cooptés par les forces colonialistes ou néocolonialistes. Dans la mesure où la division du monde en continent est elle-même très problématique et discutable, c’est donc la conscience historique qui détermine le rapport à l’espace qui reste lui-même porteur jusqu’à aujourd’hui de cette » ligne de couleur « .
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, vous expliquez que le panafricanisme est né en Haïti, c’est à dire ?
En réalité, le panafricanisme est né dans les Amériques, mais son concept politique, c’est-à-dire l’unité des peuples africains dans un ensemble fédéral, existe depuis bien plus longtemps en Afrique, à travers par exemple les royaumes et empires sahélo-soudanais. Le Ghana, le Mali, le Songhay, avaient des structures politiques et sociales panafricaines, regroupant une mosaïque de peuples dans des alliances sophistiquées.
Maintenant, Saint Domingue, en 1791, était la colonie la plus riche des Amériques, avec une main d’œuvre servile africaine représentant 90% de la population. La révolution menée à ce moment par des Africains de diverses origines marque surtout un tournant historique : la première abolition imposée par des esclaves aux maîtres, la fin d’un système d’exploitation économique qui va se recycler sous la forme de la dette de l’indépendance imposée par la France à Haïti, et la naissance du second État d’origine africaine qui, après l’Éthiopie, a connu depuis sa création une continuité historique et juridique.
Confronté à un ordre mondial hostile, les militants haïtiens ont ensuite compris que leur liberté n’était rien sans celle de toute la Caraïbe, de l’Afrique, et peut être même au-delà si on pense à la naturalisation dès 1805 des soldats polonais et allemands qui avaient déserté les rangs bonapartistes pour rejoindre les combattants africains. En soutenant des luttes d’émancipation ou des résistances incarnées par Simon Bolivar, José Marti ou Ménélik, les militants haïtiens comme Anténor Firmin et Bénito Sylvain ont montré que l’histoire de la naissance de leur pays, et donc le panafricanisme, devait être une force en mesure de redonner au monde son équilibre. Ainsi, aujourd’hui, au-delà de la question des réparations, beaucoup de militants panafricanistes plaident pour que Haïti, devenu membre observateur de l’Union africaine, soit véritablement investi par des projets d’émancipation autres que ceux relevant de l’humanitaire néolibéral et militariste.
Comment expliquer la relative absence de documentation, jusqu’alors, sur le sujet en français ?
La bibliographie qui existe est majoritairement en langue anglaise. Il existe un Que sais-je très ancien de Philippe Decraene, assez daté, avec pas mal d’erreurs, ainsi que quelques ouvrages comme ceux de Oruno Lara. Au départ, j’ai proposé une réactualisation du panafricanisme, en format poche. Lorsque les éditeurs de La Découverte ont reçu le manuscrit, ils ont voulu quelque chose de plus conséquent qui puisse faire référence en la matière et combler justement cette lacune historiographique. Pendant mes recherches doctorales, j’ai travaillé sur des figures du panafricanisme. J’ai principalement travaillé avec des sources anglophones, j’ai rencontré les militants engagés dans l’unité africaine, et j’ai eu l’occasion de me rendre à l’Union africaine à Addis-Abeda. J’ai pu alors confronter la logique institutionnelle et la logique militante, quelles étaient les contradictions mineures et majeures. Et je me suis engagé personnellement dans un mouvement, la Ligue panafricaine – Umoja (LP-U) [mouvement politique panafricaniste créé en France en 2012, NDLR].
J’ai eu l’occasion de rencontrer des figures historiques, peu connues, dont certaines sont aujourd’hui décédées. C’est en leur hommage que j’ai voulu écrire cet ouvrage. Mais aussi pour réconcilier les générations. Il y a beaucoup de noms du panafricanisme scandés par les jeunes de manière incantatoire mais derrière il n’y a pas forcément de substance. Avec ce livre, il s’agissait donc de donner une ligne directrice à cette histoire, de produire une réflexion sur la nécessité de ramener le panafricanisme dans une logique militante, internationaliste, et de dépoussiérer des concepts un peu galvaudés par les événements historiques qui résultent du rapport de force défavorable à l’Afrique.
Tout ce qui est scientifique et culturel, à partir du moment où ça touche l’Afrique, a nécessairement une portée politique et idéologique. Et il était nécessaire de réinscrire le panafricanisme dans l’histoire des idées, des luttes sociales, politiques et culturelles. Le panafricanisme est un mouvement très éclaté en raison de sa propre évolution, de l’inégalité des savoirs parmi les personnes qui s’en revendiquent. Certaines personnes maîtrisent les définitions du panafricanisme et les logiques annexes, celles du marxisme, du socialisme etc. Et puis d’autres sont juste dans de la posture, voire carrément de l’imposture.
Dans votre ouvrage, vous parlez à plusieurs reprises de la fracture entre l’intellectualisation du mouvement et l’intérêt populaire pour le panafricanisme.
Cela est encore présent, et fait partie de cette histoire, notamment si on continue de marginaliser les artistes. Les artistes ont fait le lien entre populaire et politique. D’où le titre de Africa Unite, issu de la chanson de Bob Marley. Avec ce livre, il s’agissait modestement de passer les frontières un peu partout dans les pays du Sud.
Nombreuses figures présentes dans cet ouvrage sont des personnages anglophones, notamment afro-américains. Est-ce à l’image de la réalité du panafricanisme ?
Il y a aussi des références contemporaines dans le milieu francophone : Thomas Sankara suscite toujours un engouement extraordinaire auprès de la jeunesse. En Afrique de l’Ouest, c’est très clivant. Là où les historiens et militants politiques Cheikh Anta Diop et Joseph Ki-Zerbo appuient le projet fédéral de Nkrumah, d’autres s’y opposent. Ainsi, Senghor s’inscrit avec Houphouët-Boigny dans le maintien de relations privilégiées avec la France, par opposition à la volonté de rupture défendue par des dirigeants et militants disparus très tôt, entre 1958 et 1961, comme Um Nyobe, Boganda, Lumumba ou Fanon.
Aujourd’hui, dans la reproduction de figures panafricaines, les sociétés africaines ont un retard de deux ou trois générations à rattraper. Il existe également des expériences plus intimes au Bénin, au Mali, au Congo, qui sont plus locales. Au Bénin par exemple, il existe des projets de retours de Caribéens, notamment la famille Jah que j’ai rencontrée, où l’Institut du Professeur Honorat Aguessy à Ouidah. Il y a donc, en dehors des grandes figures, une intimité du panafricanisme.
Comment expliquer toutefois cette relative absence de figures francophones comparativement aux références anglophones ?
Dès 1919, lors du Congrès panafricain organisé à Paris par le député français du Sénégal Blaise Diagne à la demande du militant noir américain DuBois, il y a eu une rupture entre francophones et anglophones. Depuis, les francophones ont toujours été absents des congrès panafricains. Et au moment des indépendances, la rupture, le semblant de rupture qu’on a pu voir dans le milieu anglophone, on ne l’a pas vu dans le mouvement francophone où on est resté aligné sur Paris, sur le référent de la métropole. Dans l’espace anglophone, il y a une diversité d’expériences : la situation africaine, la situation afro-caribéenne, la situation noire américaine, la situation jamaïco-britannique…
Toute cette diversité de situations a provoqué du débat, une circulation des idées, et aussi de la réflexion, de la théorisation et un autre rapport à la culture politique. Étant donné que le modèle britannique est empreint d’une tradition monarchique parlementaire et multiculturaliste tandis que le modèle français est républicain, centralisé et assimilationniste, les lectures divergent concernant l’héritage colonial. Ce qui permet de sortir de ce paradigme post-colonial qui brouille l’analyse comparée, notamment du point de vue de l’histoire politique de l’Afrique et des Caraïbes, c’est précisément d’introduire le panafricanisme comme critère d’analyse des interactions.
Évidemment, il y a eu des étincelles comme Présence africaine [les éditions, Paris / Dakar, NDLR], les congrès de la Sorbonne, des figures météores comme Frantz Fanon, des figures censurées comme Aimé Césaire, qui ne sont pas non plus des historiens en tant que tels mais tout de même des références, y compris pour le monde anglo-saxon. Il y a donc cette frilosité, ce caractère subversif qui a manqué dans les situations africaines et afro-françaises, également une répression qui a éliminé un certain nombre de figures, de mouvements comme la FEANF [Fédérations des étudiants africains en France, NDLR] à la fin des années 50 qui auraient pu porter cette dynamique. Soulignons également une logique de prédation au niveau de la pensée, qui fait que beaucoup d’intellectuels africains francophones sont contraints à s’exiler ou à céder d’un point de vue idéologique pour survivre.
Existe-t-il un panafricanisme lusophone ?
Il y a très peu de choses, de documentations sur le panafricanisme dans le monde lusophone. Or, il y a une jeunesse dans cet espace qui est très migrante, potentiellement très consciente des enjeux en raison du fait que leurs parents ont souvent été formés dans le cadre des mouvements de libération. Les ex-colonies portugaises ont cette particularité d’être plus éclatées géographiquement que les autres territoires colonisés, et du coup, après les guerres civiles en Angola et au Mozambique notamment, on est davantage entré dans l’écriture d’histoires nationales plutôt que régionales ou panafricanistes. Il y a donc un déficit à ce niveau-là. Déficit qui ne peut pas être comblé par le simple fait que le Brésil, qui héberge la plus importante diaspora africaine, se soit engagé à financer les volumes de l’Histoire générale de l’Afrique en portugais. Il y a enfin un mouvement panafricaniste embryonnaire à Lisbonne qui apparaît assez isolé mais dynamique. Le monde lusophone est en effet un défi très intéressant.
Quels sont les enjeux, en Europe, du panafricanisme ?
L’Europe a toujours été un lieu de rencontre, d’échange, mais aussi de répression. L’enjeu est de créer de nouveaux espaces, et de nouvelles formes de libération, dans une perspective internationaliste. L’Europe est confrontée à un certain nombre de crises, mais elle maintient une politique de prédation sur le continent africain, et l’opinion publique sur l’Afrique est baladée entre l’image d’un continent de tous les malheurs, et celui d’un espace émergent. Et il y a l’interrogation de toutes les diasporas africaines présentes ici et qui se posent la question de l’intégration ou du retour.
Justement, plutôt que du panafricanisme, nombres d’intellectuels et de personnes se revendiquent davantage d’une identité afropéenne ou afropolitaine. Qu’en pensez-vous ?
Les identités afropéennes et afropolitaines me semblent tout à fait dans l’air du temps, c’est-à-dire à la fois décevantes et stimulantes. Elles sont largement apolitiques et extra-africaines, en ce qu’elles résonnent à mes oreilles comme des notions de classe, de division intellectuelle du travail, ou de séparation économique et sociale entre les Africains, selon qu’ils auraient ou n’auraient pas la liberté d’aller et venir depuis et vers l’Afrique. La condition afropolitaine peut faire penser à celle des » évolués « , des Africains jugés plus » civilisés » par le pouvoir colonial, selon les critères du pouvoir colonial. Le risque est donc de parler d’afropolitanisme sans étudier les analyses de DuBois sur la théorie de la » double conscience » ou de Fanon sur le facteur cosmétique de l’identité et de l’aliénation dans Peaux noires masques blancs. Toujours dans l’analyse de DuBois, les Afropolitains sont-ils ces 10% d’Africains dont on pense qu’en atteignant un très bon statut économique et social, ils joueront un rôle d’ascenseur pour les autres ? Je ne pense pas, ce n’est pas le cas. Le panafricanisme, malgré les critiques cherchant à le faire passer comme un projet utopique ou exclusif, contient cette idée de regroupement et de solidarité qui me paraît nécessaire pour affronter l’individualisme d’un monde en occidentalisation croissante.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’opposer, mais de faire en sorte que les identités évoquant une réconciliation ou une hybridité comme » afropéen » ne soient pas tout simplement de nouvelles formes d’assimilation, de déculturation et de domination dans un monde où nous savons que la culture dominante reste bien souvent celle de l’économie ou du système idéologique dominant.
Dans un entretien récent accordé à un magazine français, l’écrivaine nigériane Chimananda Ngozi Adichie rejette d’ailleurs cette étiquette qu’on lui colle en disant » Africaine oui, Afropolitaine sûrement pas « . Elle explique qu’elle ne comprend pas la nécessité de créer une catégorie pour un type de personnes qui a toujours existé. L’histoire du panafricanisme est faite d’hommes et de femmes d’origine africaine qui n’ont jamais cessé de voyager, de relier les mondes et de croiser les identités. C’est l’histoire du panafricanisme qui contient les couches de sédimentation majoritairement africaines et accessoirement non-africaines sur lesquelles les identités afropéennes et afropolitaines effleurent, mais de manière superficielle.
Quel est l’enjeu du panafricanisme en Afrique ?
En termes de stratégie et de philosophie politiques, on ne peut pas utiliser une idéologie étrangère pour lutter contre une autre idéologie étrangère ; on ne peut pas utiliser le socialisme pour lutter contre le libéralisme. Ça n’a aucun sens. Il faut au contraire utiliser une idéologie qui soit conforme à la trajectoire historique des populations concernées pour amener à une libération alternative. Et cette réflexion est éminemment importante car dans ce rapport à l’ultralibéralisme, l’Afrique fait l’objet d’un consensus sino-occidental le jour, et d’une intense guerre économique la nuit. Pour sortir de ces alternatives qui sont toutes les deux des impasses, il faut se tourner vers le panafricanisme.